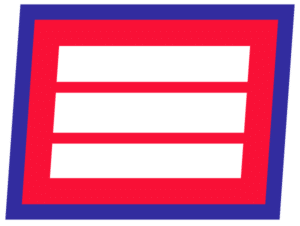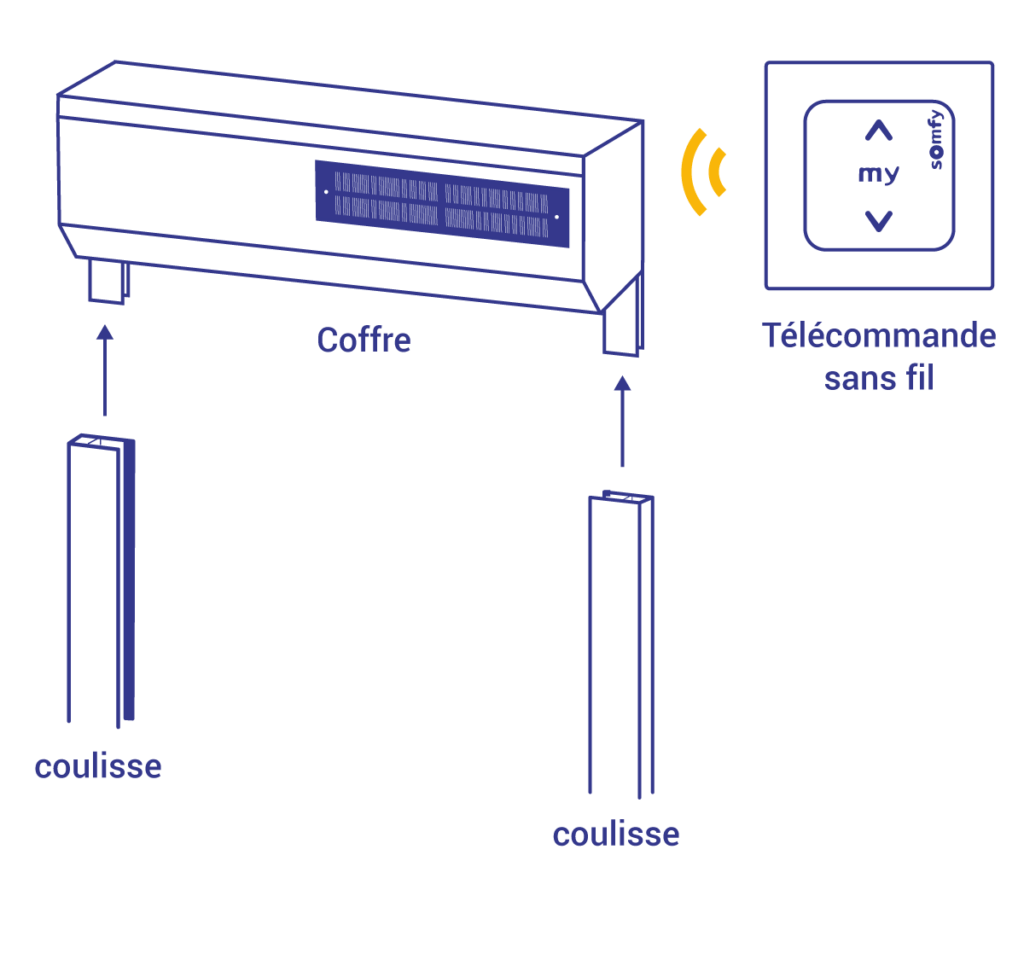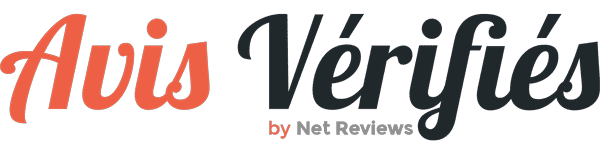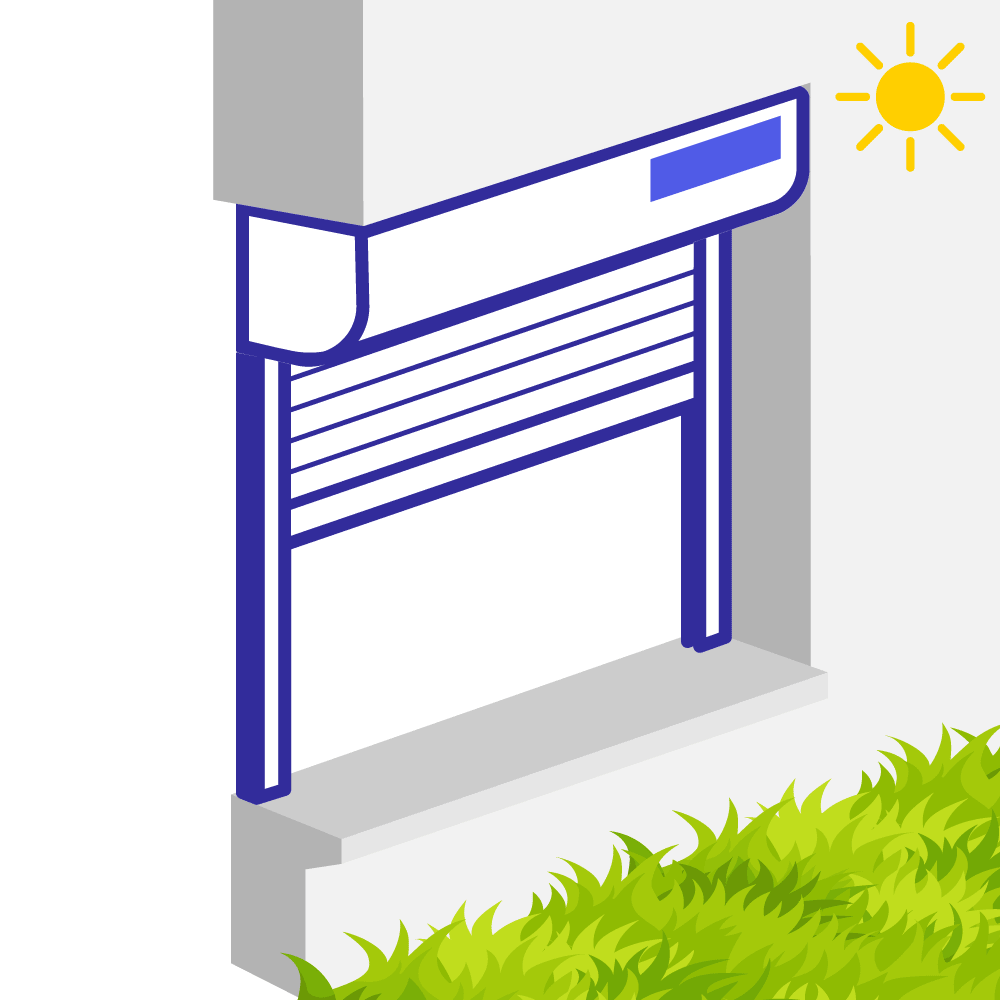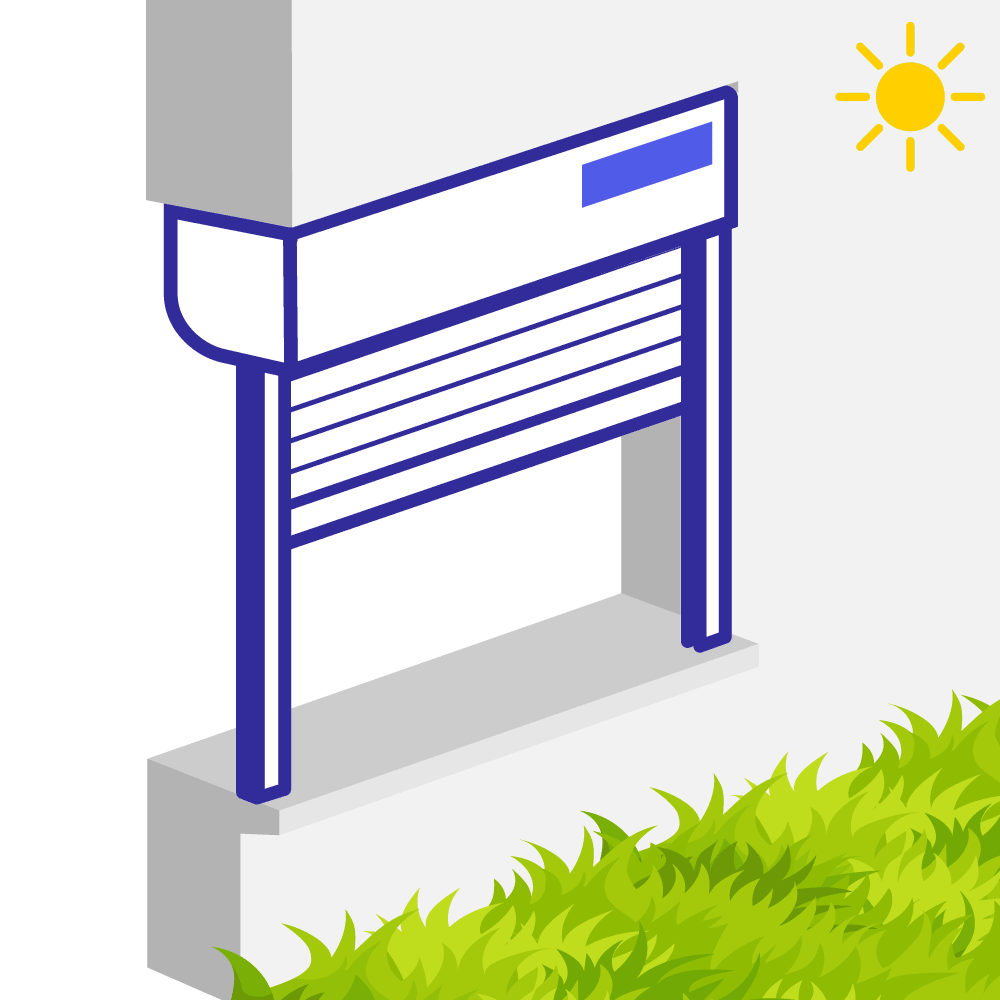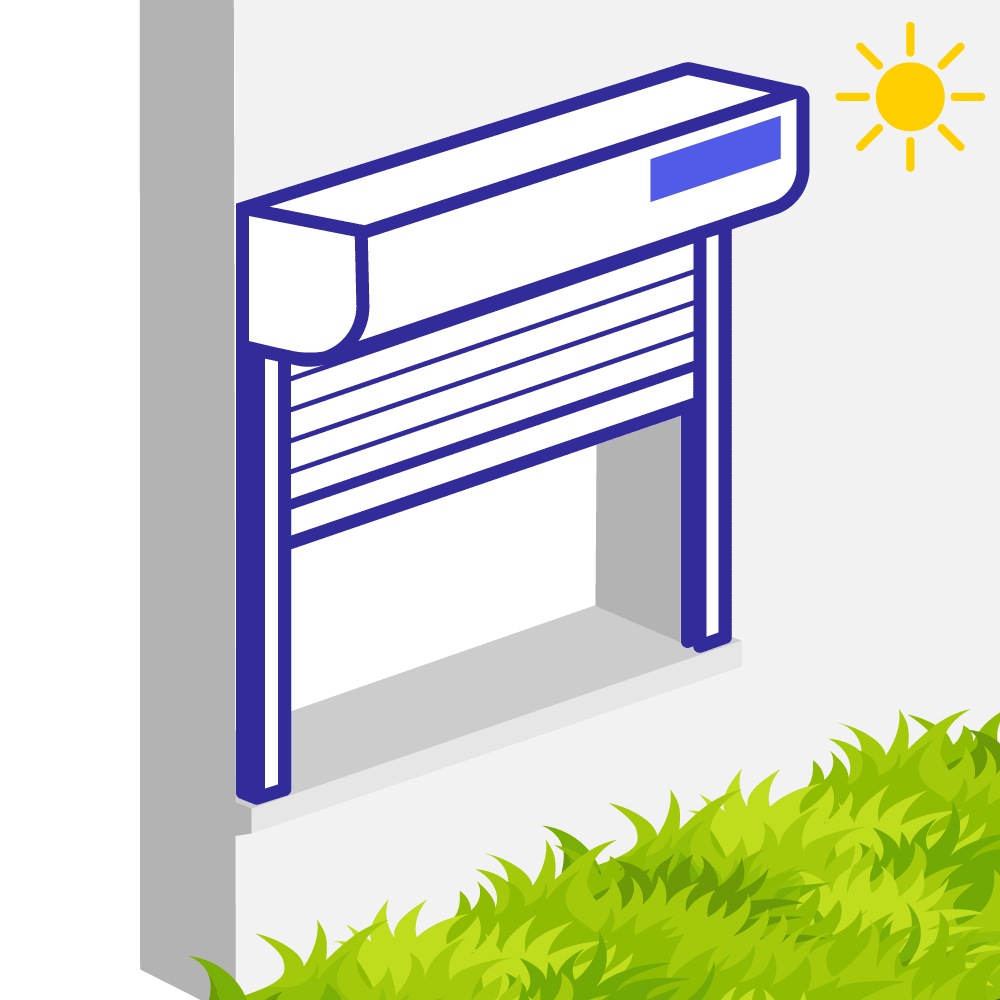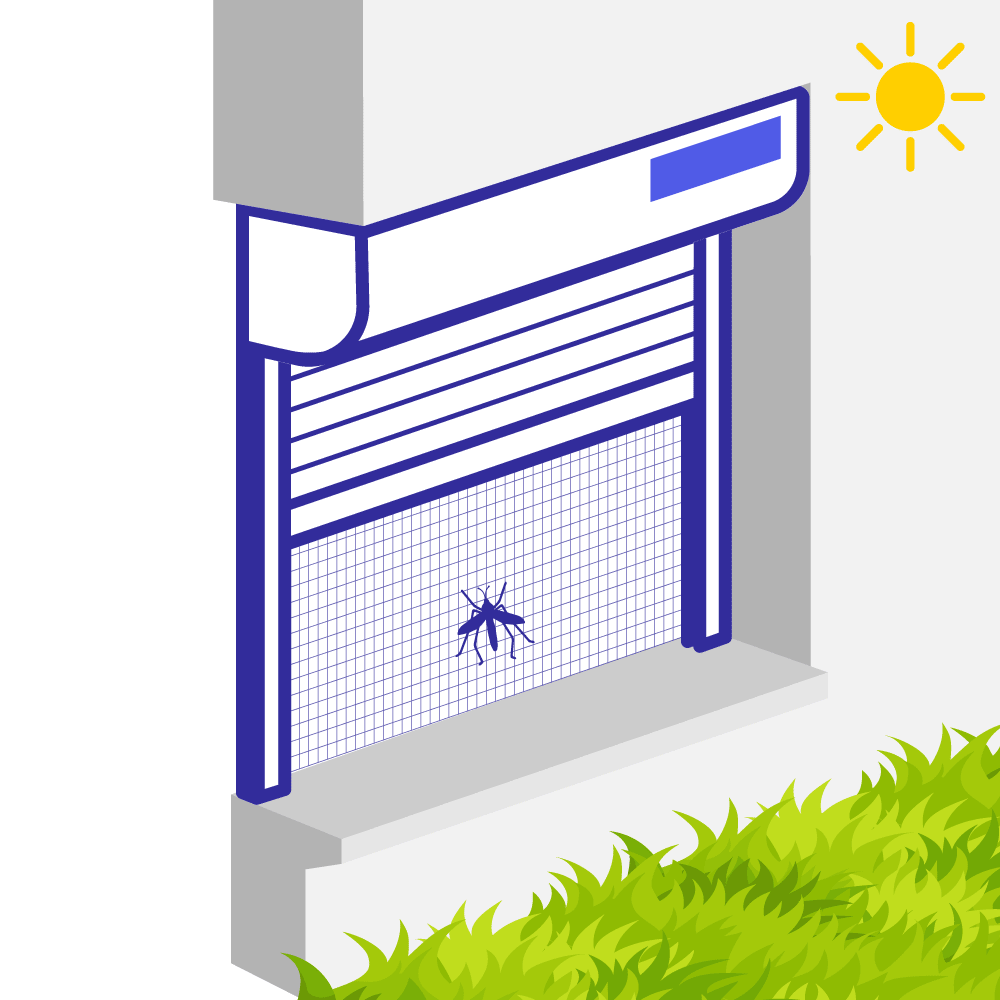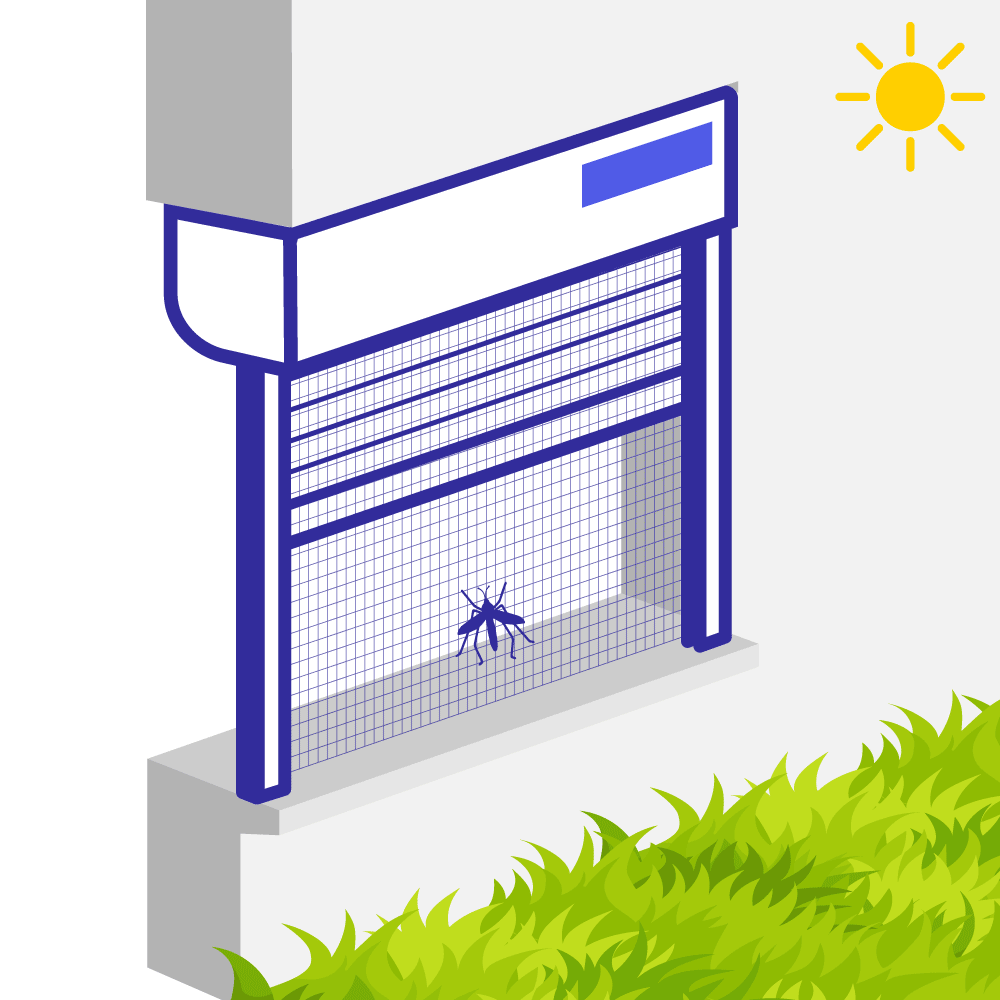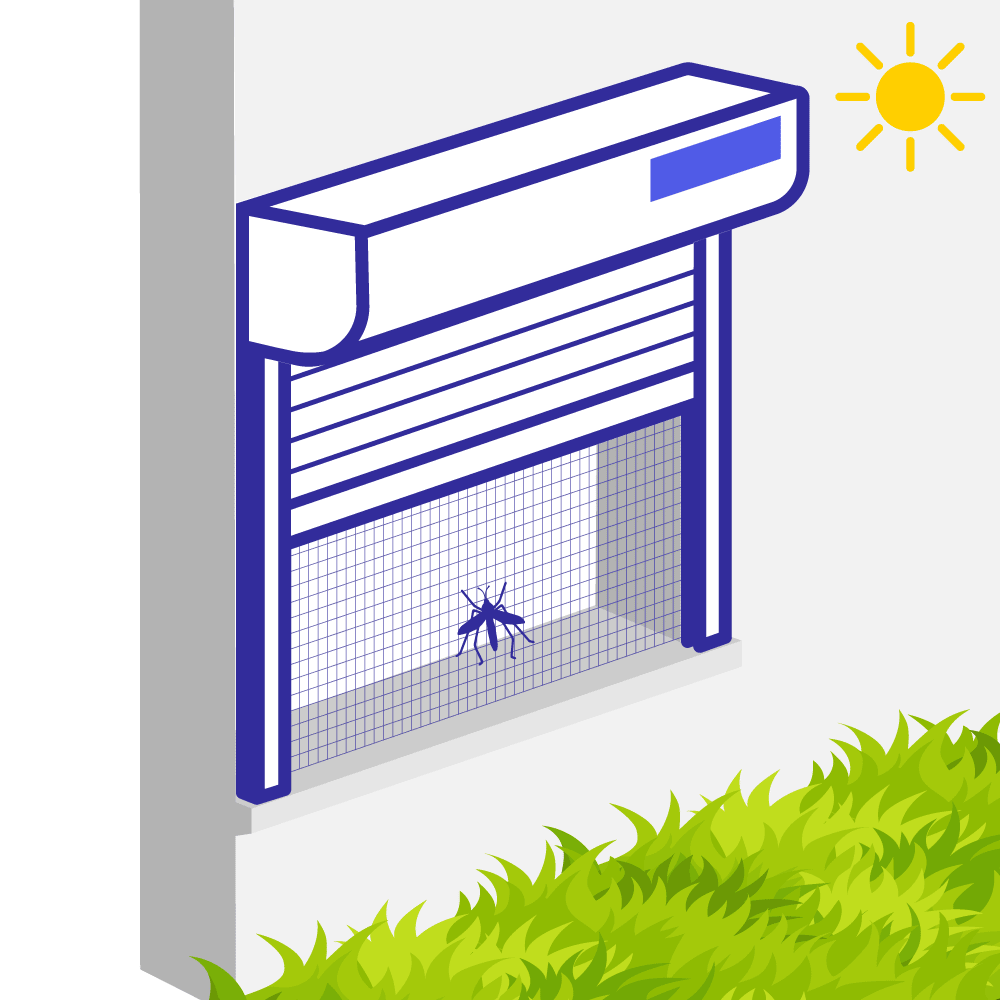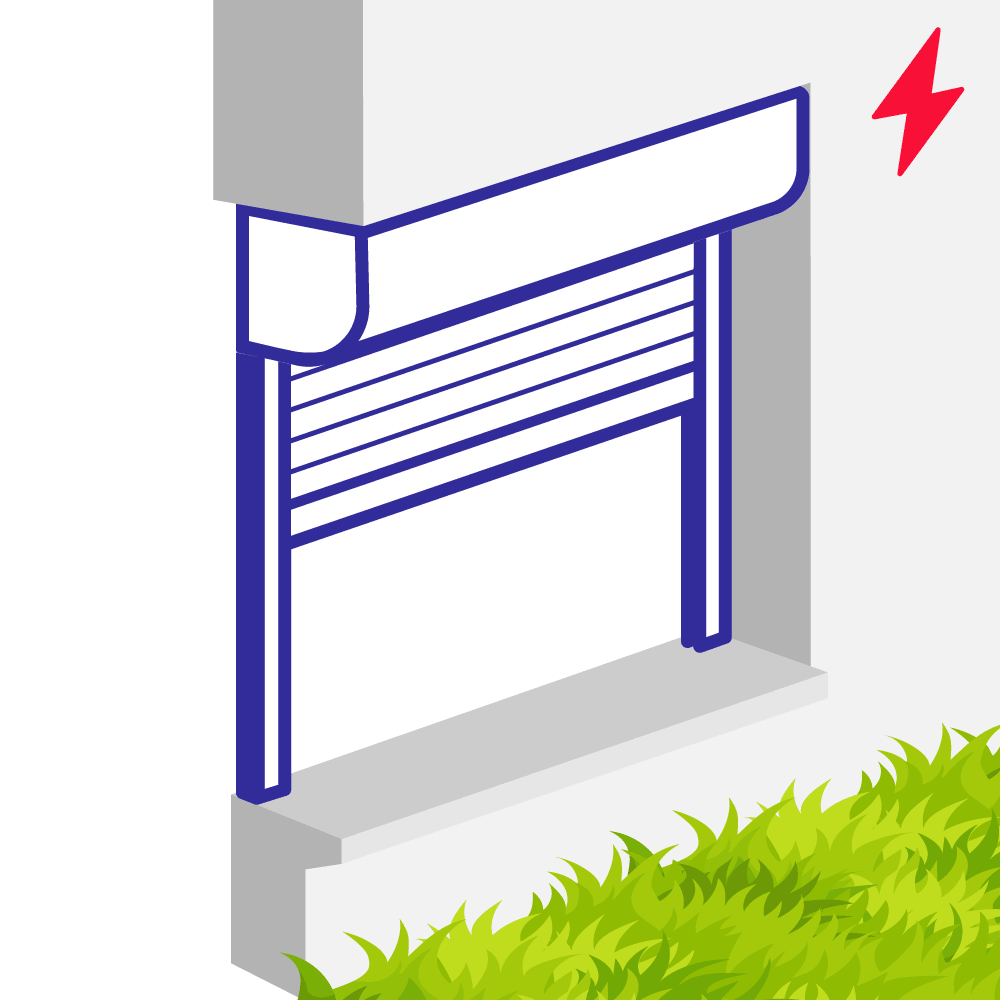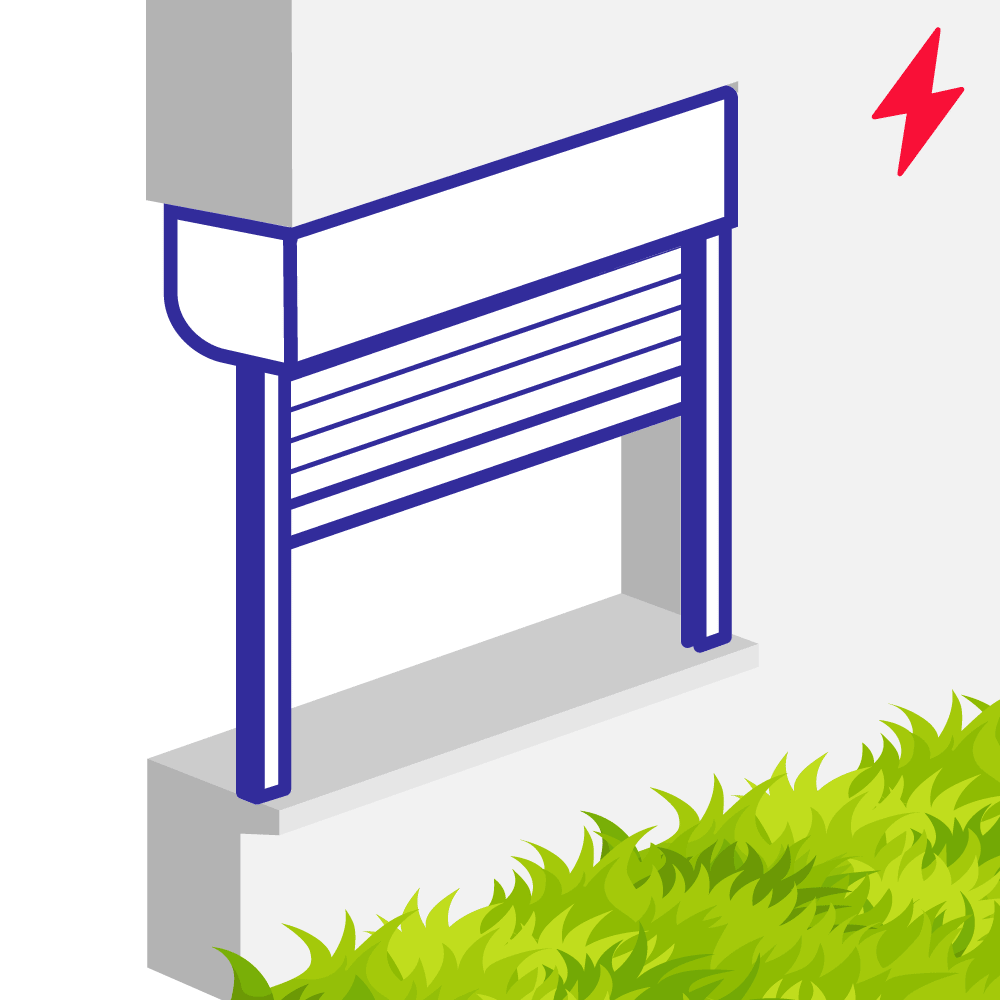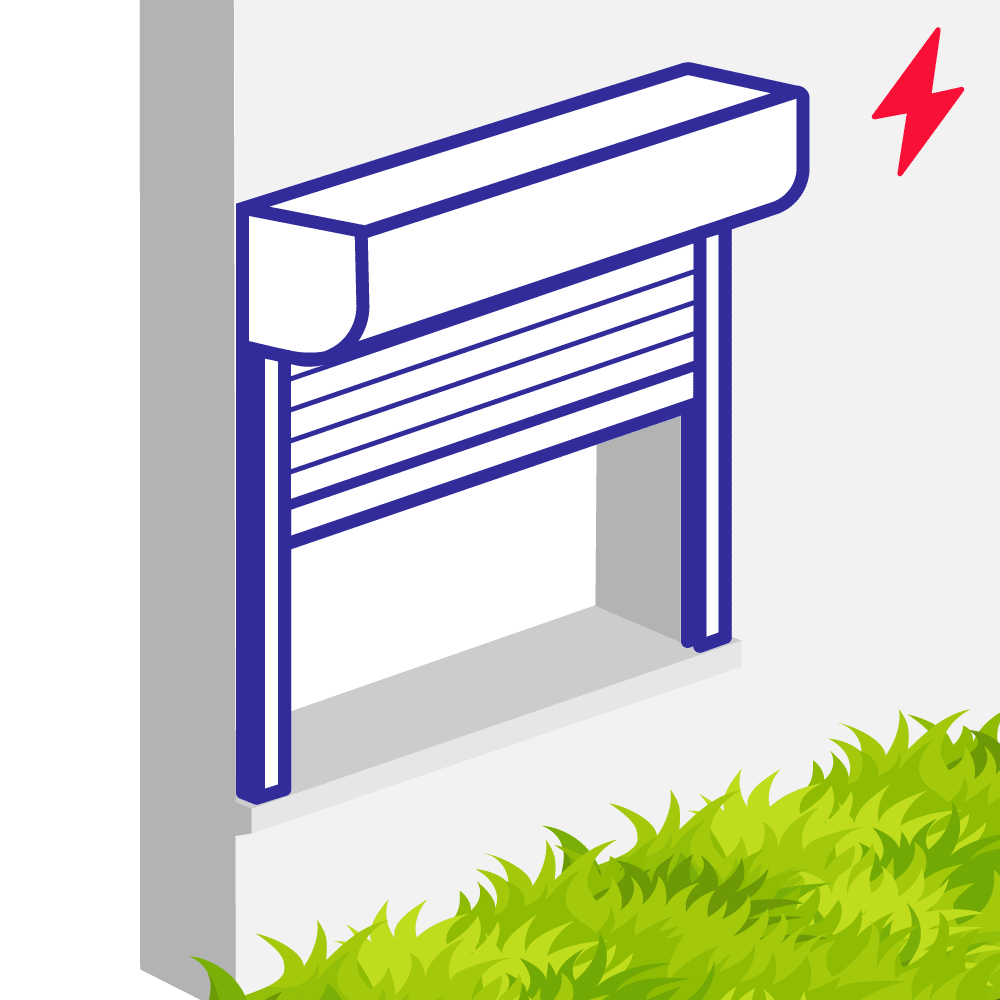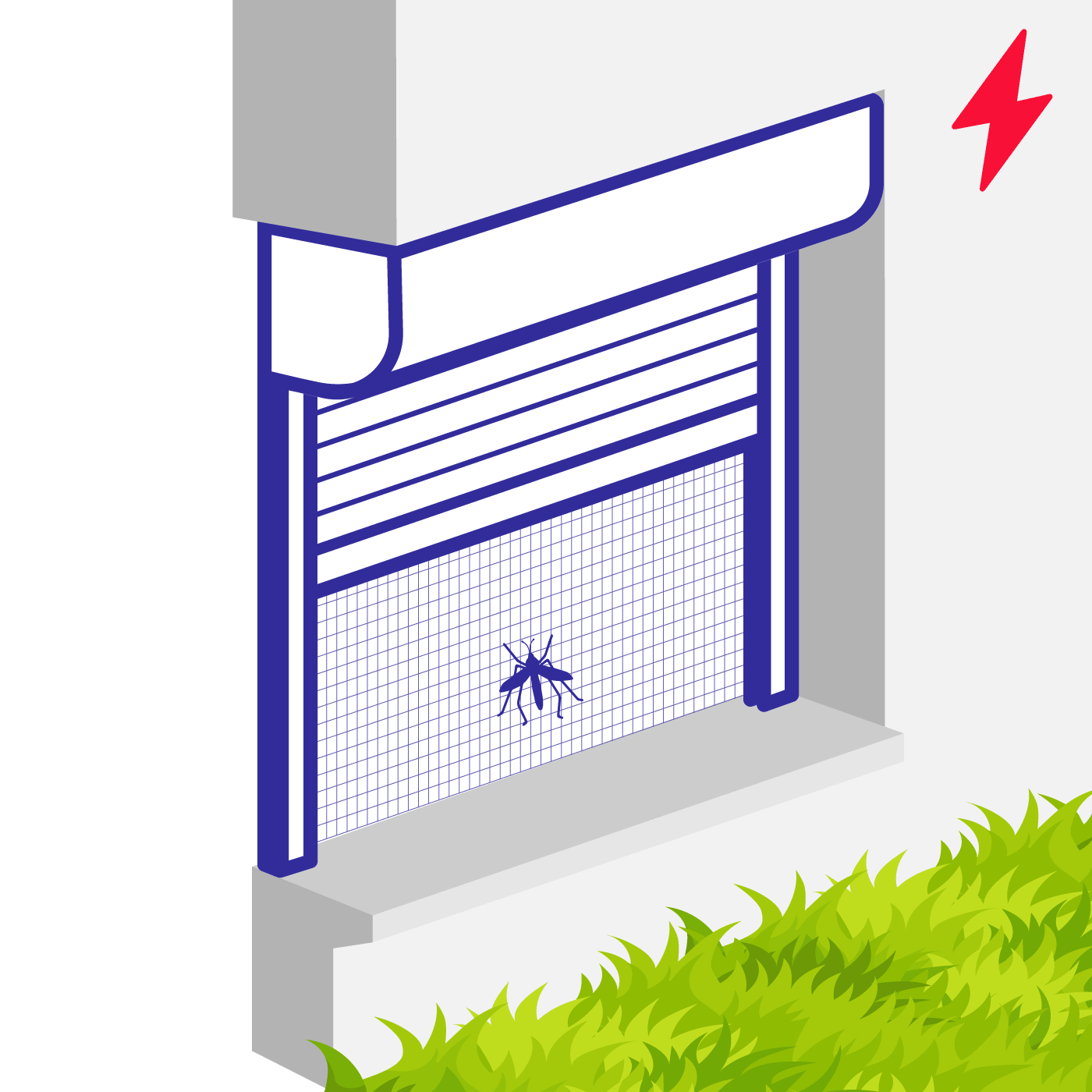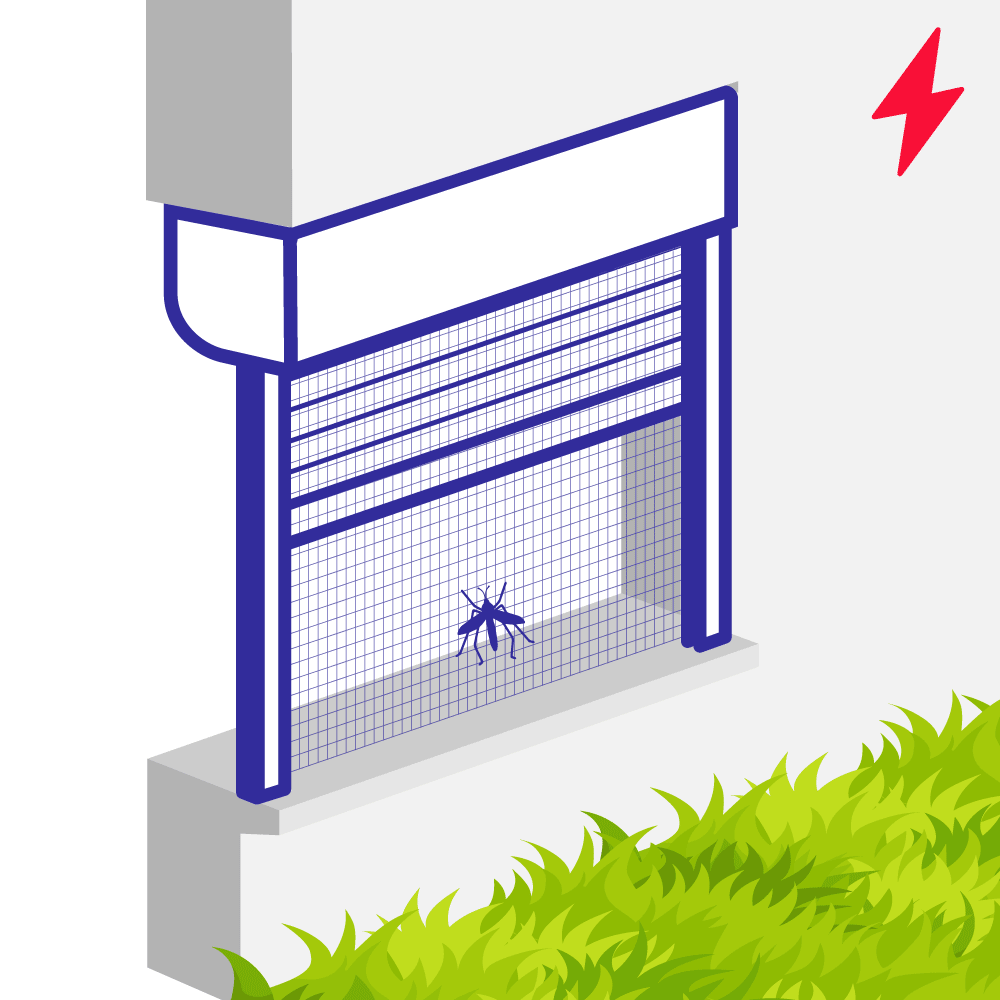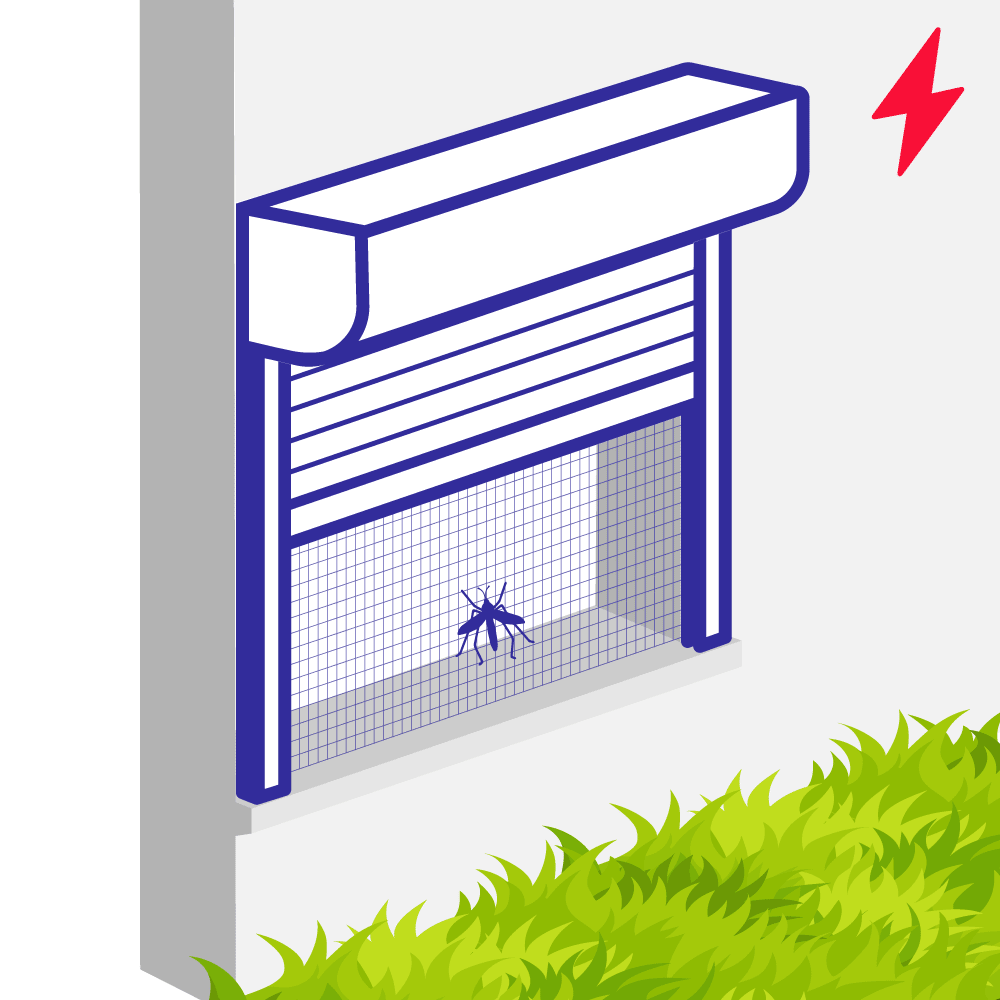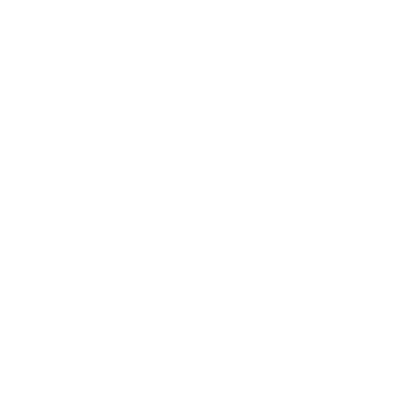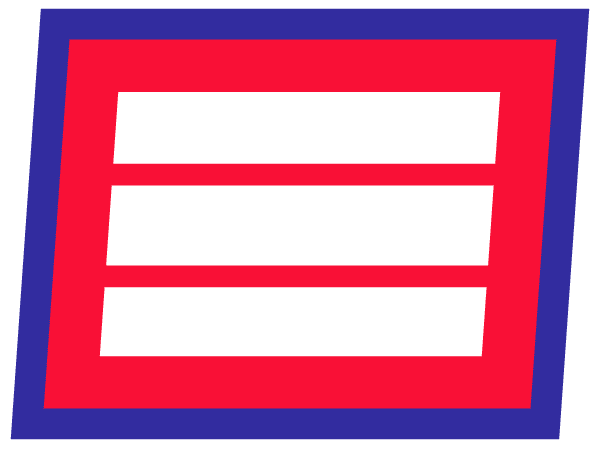Volets ALU somfy io livrés en 21 jours et garantis 10 ans
Transport OFFERT à partir de 1500 euros
- Tutos
-
-
-
Tout le monde peut se lancer !
Regardez nos tutoriels avec vidéos consacrés à la prise de mesure et à la pose d’un volet roulant.
-
-
-
- Nos atouts
- FAQ
- Photos
-
-
-
Nos volets roulants en photos
Découvrez nos produits mis en situation et un aperçu de leur fabrication.
-
-
-
⭐ 15% de remise dès 2000 € de panier ⭐
⭐ Tahoma OFFERTE dès 6 volets ⭐